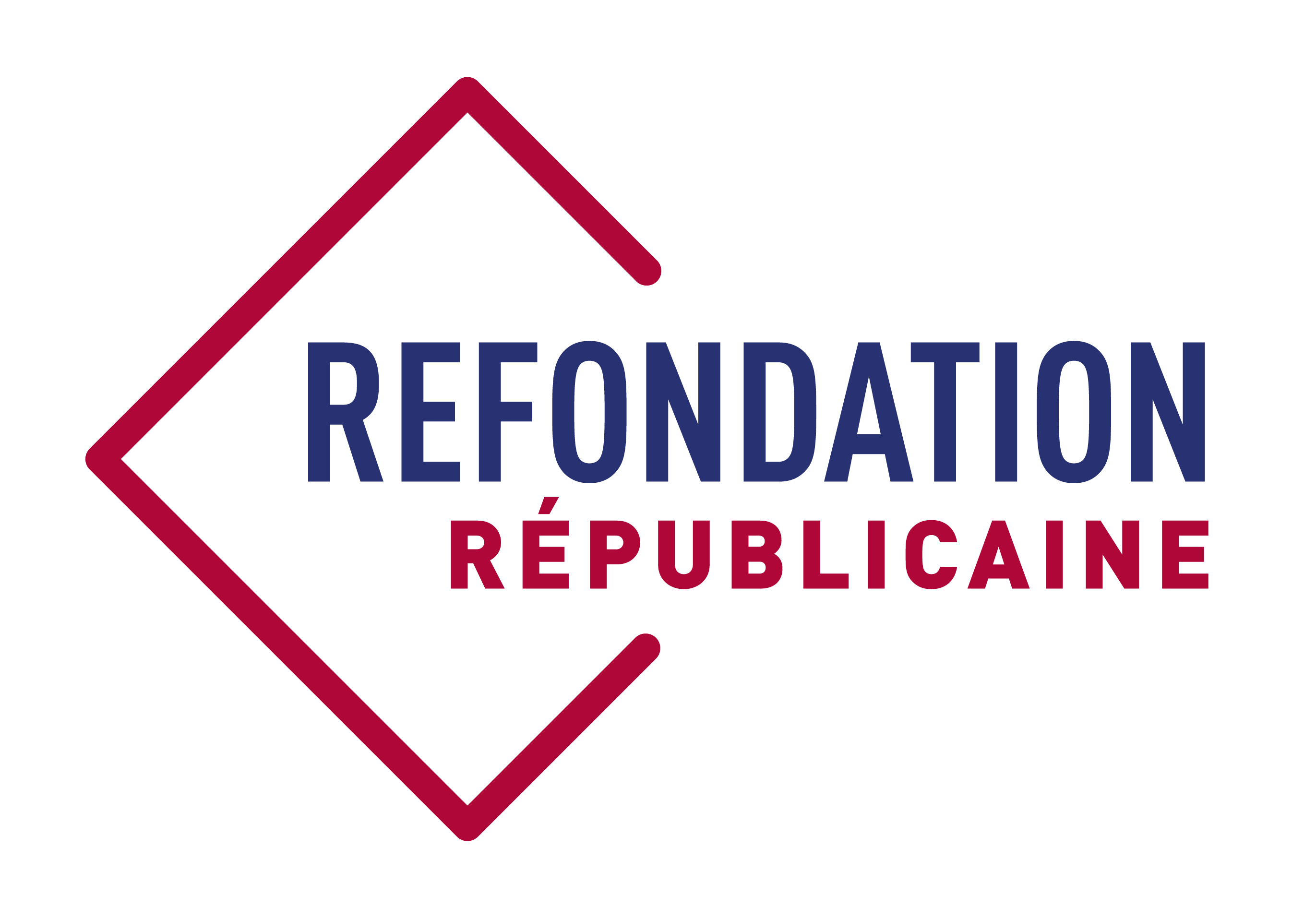Entretien de Joachim Imad, directeur de la Fondation Res Publica et membre du bureau de « Refondation républicaine » pour le Figaro Vox, publiée le 11 février 2022.
FIGAROVOX. – La Fondation Res Publica a récemment organisé un colloque intitulé «La souveraineté alimentaire, un enjeu pour demain» afin d’évoquer les défis agricoles auxquels l’Europe fait face et de proposer un panorama des équilibres et des dynamiques à l’œuvre. Comment définissez-vous le concept de souveraineté alimentaire ?
Joachim IMAD. – Les débats alimentaires, que l’on pensait réglés, ont récemment fait leur retour. La crise du coronavirus y a largement contribué. Celle-ci a en effet mis en lumière de nombreuses dépendances stratégiques et fait ressurgir une « peur de manquer » au sein d’une grande partie de la population française. Plus généralement, nous assistons depuis quelques années à la sortie du cycle naïvement qualifié de « mondialisation heureuse ». Ses thuriféraires considéraient que la préservation des forces productives de notre société était secondaire. La France avait selon eux tout intérêt à privilégier les services et la finance, tout en se reposant sur la « ferme brésilienne et l’atelier industriel chinois ». Cette vision, inscrite à rebours du contrat social français imaginé à la libération, a montré ses limites.
Les idées de souveraineté et d’indépendance, longtemps occultées, sont alors revenues en force. La notion de souveraineté alimentaire ne renvoie pas comme certains le croient à l’autosuffisance. Cette dernière implique en effet que la production nationale puisse satisfaire l’ensemble de la consommation intérieure. Distinguons enfin la souveraineté alimentaire de la sécurité alimentaire, c’est-à-dire la capacité à satisfaire l’ensemble de la demande intérieure sans pénurie.
La souveraineté alimentaire, telle que nous l’avons définie, correspond à « la capacité et au droit pour un pays ou un groupe de pays de rester maître de sa politique agricole et alimentaire, commerce extérieur des produits alimentaires inclus, sans nuire aux autres pays ». Ce concept correspond à la ligne de conduite adoptée, depuis longtemps, par une large partie des gouvernements. Notre publication propose d’ailleurs un exposé sur la manière dont les deux grands ensembles géostratégiques que sont les États-Unis et la Chine portent leur aspiration à l’autosuffisance et défendent leur souveraineté alimentaire. Ceux-ci n’hésitent pas en effet à recourir à la planification et mettent en œuvre, sous l’influence d’une mémoire historique vivace, des politiques destinées à limiter leurs dépendances.
Un rapport sénatorial de 2019 révélait que 20% de l’alimentation française était importée. Ce chiffre qui a doublé depuis les années 2000 soulève des questions sur le devenir de notre souveraineté alimentaire. Plus largement, la situation de l’agriculture française vous semble-t-elle inquiétante ?
Depuis 1976, année de grande sécheresse, la France a toujours été excédentaire sur les produits agricoles et alimentaires. Grâce notamment à la politique agricole commune (PAC), la France était devenue le premier producteur et exportateur européen. Ses résultats agricoles lui ont longtemps permis de limiter le déclin de sa balance commerciale générale, en dépit de sa désindustrialisation.
Si la France demeure une grande puissance agricole européenne, l’érosion de ses performances commerciales en matière agroalimentaire est en revanche nette depuis le milieu de la décennie 1990. Alors qu’elle était jusqu’aux années 2000, la deuxième puissance mondiale exportatrice, elle occupe aujourd’hui la septième place de ce classement, derrière l’Allemagne et les Pays-Bas. L’excédent commercial français sur l’agroalimentaire a été divisé par deux entre 2011 et 2017 et a atteint en 2020 son plus bas niveau depuis le début du millénaire. Il ne tient plus désormais que grâce aux échanges avec les pays tiers, la France étant devenue déficitaire dans ses échanges avec les pays européens, du fait d’un important déficit de compétitivité.
Au-delà de la situation commerciale de son agriculture, c’est l’ensemble de la ruralité française qui souffre, ce dont témoignent les données réunies dans l’excellente note du Haut-Commissariat au Plan « L’agriculture, enjeu de reconquête ». La main-d’œuvre agricole française, vieillissante, a par exemple été divisée par quatre entre la fin des années 70 et les années 2000, si bien que plus de 200 000 emplois saisonniers étaient à pourvoir en France entre mars et mai 2020. La France devrait voir le nombre de ses exploitations agricoles tomber sous les 330 000 au milieu des années 2020 (soit une baisse de 25 % en 5 ans). À cette crise d’attractivité et à ces problèmes démographiques, s’ajoute la déliquescence de situation morale et économique de ses agriculteurs. Le revenu net imposable mensuel moyen des exploitants agricoles français était seulement de 1390 euros en 2017 et près d’un agriculteur sur cinq n’a pas été en mesure de se verser de revenu …
Quelles évolutions préconisez-vous pour rééquilibrer la balance commerciale agricole française et redresser la pente ?
Les causes de notre déclin agricole sont plurielles. Certains évènements historiques et dynamiques intra-européens nous ont clairement été préjudiciables, à l’image de la réunification des deux Allemagne et plus encore de l’élargissement de l’UE à l’Est, c’est-à-dire vers des pays à bas coûts qui ont permis à l’Allemagne et à la Pologne de se constituer une sorte d’hinterland agricole. La montée de la Chine, l’ouverture à la globalisation et à la concurrence généralisée, mais aussi les tensions commerciales russo-européennes ont accéléré la recomposition de la hiérarchie des nations exportatrices sur le plan agroalimentaire.
La France ne redressera pas la pente si elle n’agit pas sur son déficit de compétitivité qui explique à hauteur de 70 %, selon la Direction générale du Trésor, la diminution de son excédent commercial agroalimentaire. L’un des principaux problèmes tient tout d’abord au coût du travail dans ce secteur en France. Celui-ci est bien plus élevé et augmente beaucoup plus vite depuis les années 2000 que chez ses concurrents européens. Ces derniers profitent des règles européennes, notamment sur le travail détaché, pour organiser un dumping social : en matière de maraîchage par exemple, le coût horaire du travail en France est respectivement 1,7 et 1,5 fois plus élevé qu’en Espagne et qu’en Allemagne.
La fiscalité constitue un autre problème majeur. Les impôts de production représentent en effet 3,2 % du PIB national français, contre 1,6 % en moyenne dans l’UE et 0,4 % en Allemagne, et le taux d’imposition sur la production agro-alimentaire est le deuxième plus élevé en part de valeur ajoutée (5,5 % en moyenne sur la période 2008-2016) parmi les branches productives françaises. Il faudrait également conduire une réflexion sur l’inadéquation de certaines productions françaises à la demande mondiale ainsi que sur la stagnation et le trop faible niveau du taux d’investissement dans le secteur.
S’il nous faut préserver des normes environnementales exigeantes, on peut enfin s’interroger sur le fait que les réglementations en vigueur en France soient les plus contraignantes d’Europe. Celles-ci tirent les prix à la hausse, poussant les consommateurs français à privilégier des produits importés, ce qui accélère la destruction de nos outils de production alimentaire.
La France a une marge de manœuvre importante sur tous ces plans. Mais ses efforts resteront vains si notre pays et plus largement l’Europe ne se réarment pas. Du fait d’une ouverture trop grande au libre-échange international, d’une planification insuffisante mais aussi d’une incapacité des États membres à s’accorder sur la nécessité d’une taxe carbone aux frontières et de clauses miroirs, l’Europe n’a plus aujourd’hui les moyens de sa souveraineté alimentaire. Nous importons aujourd’hui des produits étrangers qui ne respectent pas les normes européennes, ce qui constitue une concurrence déloyale et aggrave l’érosion de nos performances agricoles. Notre publication insiste donc sur la nécessité de taper du poing sur la table pour changer les règles du commerce international qui, depuis 1992, formatent les politiques agricoles. La question est de savoir si nous sommes prêts à rompre avec notre naïveté stratégique et à redevenir un continent de producteurs pour nous faire une place au sommet des puissances agricoles indépendantes.
En parlant de l’Union européenne, que contient la stratégie Farm to forkdéfendue par la Commission ? Celle-ci va-t-elle dans le sens de l’affirmation d’une Europe-puissance sur la scène internationale et d’une plus grande sécurité alimentaire, pour l’Europe mais aussi pour les pays tiers ?
Cette stratégie est la déclinaison agricole du Pacte vert européen. Elle vise, à échéance 2030, à diminuer les émissions de gaz à effet de serre, notamment en diminuant les usages de terre de 10 %, et à pousser à 25 % la part du biologique dans notre agriculture. Dans le même temps, l’usage de pesticides et d’antibiotiques vétérinaires doit baisser de moitié, celui des engrais de 20%, et les importations de soja ont vocation à être réduites à néant.
Ces objectifs, en apparence nobles sur le papier, sont contradictoires et pourraient avoir des conséquences réelles délétères sur de nombreux plans, comme l’anticipent les études du département américain de l’agriculture, de l’Université de Kiel, de l’Université de Wageningen mais aussi du Joint Research Centre, laboratoire rattaché à la Commission européenne ! Gênée par ces prévisions, cette dernière a dissimulé l’étude de façon délibérée pendant près d’un an, quitte à laisser les parlementaires européens travailler à l’aveugle sur ce texte décisif. Cela en dit long sur le poids de certains lobbies à Bruxelles et sur l’opacité qui y sévit… Si l’on se fie aux différents rapports mais aussi à l’avis de grands syndicats agricoles européens, la stratégie Farm to Fork devrait aboutir à une baisse des niveaux de production pouvant aller de 10 à 15 %. Une chute des exportations (sans doute autour de 20 %) et une hausse des importations s’ensuivront logiquement. De nouvelles dépendances verront donc le jour, au détriment de notre balance commerciale et de notre souveraineté alimentaire. Alors que la demande alimentaire mondiale devrait croître de 50 à 70% d’ici 2050, la voie empruntée par l’UE est extrêmement inquiétante. Les consommateurs européens pourront toujours manger à leur faim mais verront leur pouvoir d’achat alimentaire se restreindre (de 17% selon le département américain de l’Agriculture), tandis que des dizaines de millions d’individus hors d’Europe basculeront dans l’insécurité alimentaire. Tout cela est révélateur de l’inconséquence des politiques de l’UE et de leur déconnexion avec les demandes des peuples.
Le bénéfice écologique de cette stratégie, principal argument de ses défenseurs, est enfin très incertain. Les études démontrent qu’environ deux tiers des émissions de gaz à effet de serre économisées en Europe seront simplement exportées vers les pays tiers desquels nous importerons la nourriture que nous aurons cessé de produire. Si l’on ajoute à cela les dégradations environnementales liées aux transports et à la déforestation, le bilan écologique de cette stratégie apparaît plus que navrant. Aggravation de nos dépendances et relégation de l’Europe dans la hiérarchie mondiale, externalisation de la pollution, chute du revenu des agriculteurs, essor de la précarité alimentaire et baisse du pouvoir d’achat : la fuite en avant environnementaliste ne fait pas une politique. Il serait temps que les Européens, dont le continent est de loin le plus en pointe en matière d’efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’intègrent.