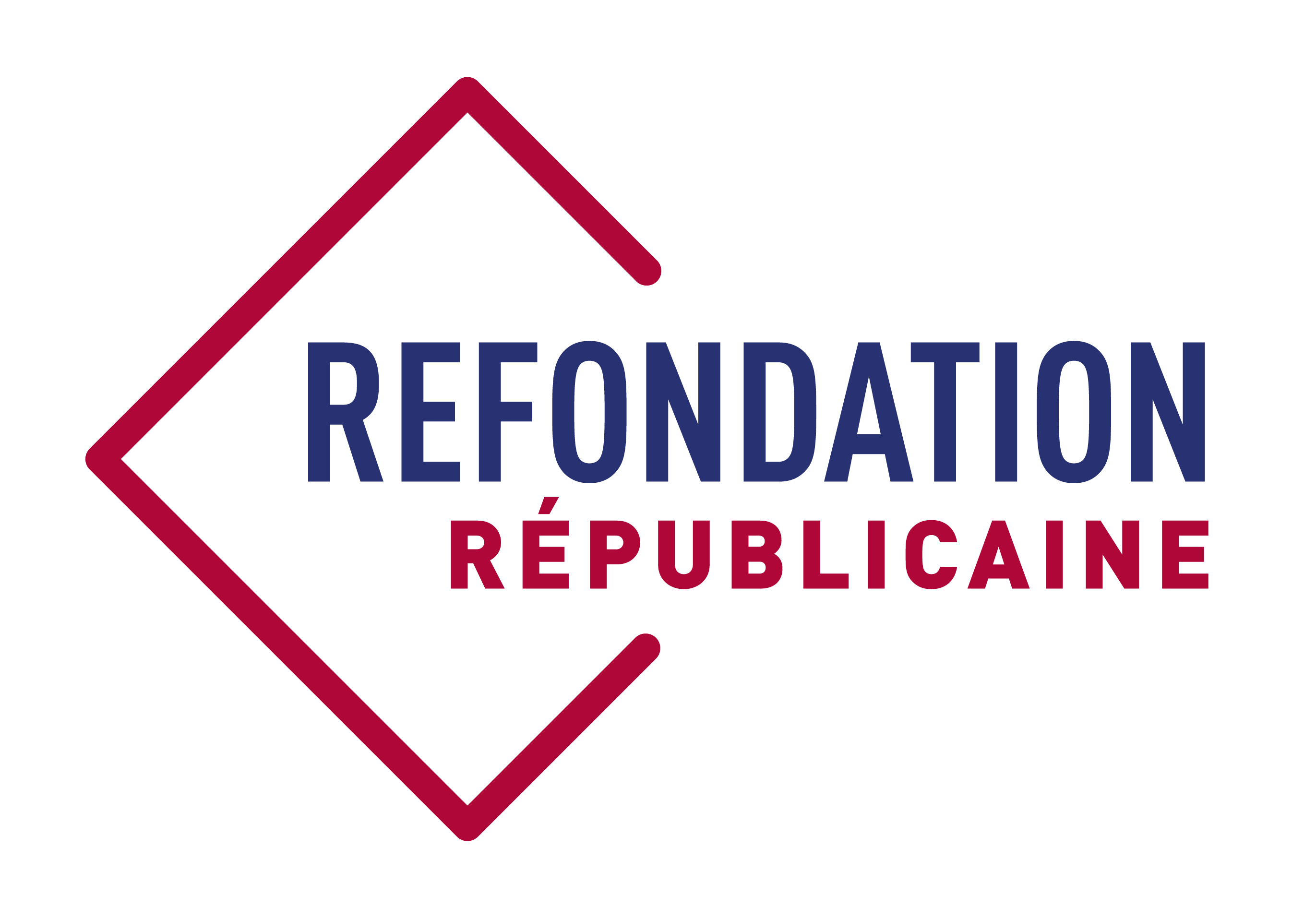Entretien de Joachim Imad, directeur de la Fondation Res Publica et membre du bureau de « Refondation républicaine » pour le Figaro Vox, publiée le 3 décembre 2021.
FIGAROVOX. – La Fondation Res Publica s’est penchée, à l’occasion d’un colloque, sur la formation des professeurs des écoles, à l’aune notamment des résultats inquiétants des élèves français dans les classements internationaux. La réussite des élèves dépend-elle entièrement de la qualité des enseignants ?
Joachim IMAD. – De nombreuses enquêtes attestent en effet du déclassement éducatif de notre pays. La France figurait parmi les premiers pays d’Europe en mathématiques dans les années 1990. Le classement TIMSS 2020 place dorénavant les élèves français de CM1 et de 4ème derniers en Europe et avant-derniers de l’OCDE en maths et en sciences. Les collégiens français de 4ème d’aujourd’hui ont le niveau des élèves de 5ème de 1995. Les résultats de l’enquête Cedre de 2019 vont dans le même sens. En fin de 3ème, près d’un collégien sur quatre est désormais en difficulté en mathématiques.
Les matières littéraires n’échappent pas à cette dynamique, ce qui n’est pas surprenant lorsque l’on sait que les élèves français ont perdu, en fin de cycle obligatoire, 700 heures de français depuis 50 ans. Les études du programme de recherche Pirls sur la compréhension de l’écrit des élèves de CM1 sont très sévères et nous placent bien en deçà de la moyenne des Européens. Sur une courte dictée, les élèves de CM2 d’aujourd’hui font sept erreurs de plus que ceux d’il y a trente ans. Autre constat inquiétant : les très bons élèves français sont de plus en plus concernés par la baisse du niveau éducatif. La dernière enquête TIMSS révèle que seuls 2 % des collégiens en classe de 4ème atteignent un niveau avancé en mathématiques. La moyenne européenne s’élève à 11 % et celle de Singapour et de la Corée du Sud à 50 % !
À qui la faute ? Il est difficile de répondre à cette question tant les problèmes et les responsabilités semblent imbriqués. Comme l’écrivait Charles Péguy, «les crises de l’enseignement ne sont pas des crises de l’enseignement. Elles sont des crises de vie». Le délitement à l’œuvre tient à des causes qui outrepassent largement la seule question de l’école. Une société a l’école qui lui correspond, d’où le lien intime entre la crise de notre modèle républicain et la crise de notre école, celles-ci s’intensifiant mutuellement, comme le souligne Souâd Ayada, présidente du Conseil supérieur des programmes . Lorsque la crise de la transmission sévit dans l’ensemble du corps social et nous fait croire que le passé est par essence obsolète, lorsque les passions démocratiques rendent toute hiérarchie suspecte et alimentent le relativisme ambiant, lorsque les humanités cessent d’imprégner les consciences et que la place de l’écrit se réduit toujours plus, il est logique que notre système éducatif se porte mal.
Des problèmes spécifiques à l’école existent par ailleurs. Ceux-ci tiennent d’abord selon moi aux finalités qu’on lui attribue à tort. L’émancipation par le savoir et le développement de la rationalité n’est plus au cœur de nos objectifs. Nous vivons depuis longtemps avec l’idée que le rôle de l’école serait d’épanouir l’enfant et de lui transmettre des «compétences», terme ô combien managérial. L’école a perdu sa finalité de première d’institution de l’État, chargée d’introduire l’enfant dans un monde qui le dépasse. Cette confusion intellectuelle est source de nombreux maux, y compris dans les politiques en place pour former nos professeurs, mission pourtant capitale dans la réussite des élèves. Un professeur tire avant tout son autorité et sa légitimité de la compétence dont il est doté. Toutes les enquêtes témoignent d’un lien très fort entre qualité de la formation, enthousiasme des professeurs et performance des élèves.
Quels sont aujourd’hui les écueils français dans la formation des professeurs ?
Avant même la formation, tout part du recrutement et du trop faible niveau des admis au concours. Du fait de l’abaissement continu du niveau éducatif et de la crise d’attractivité de la profession, les professeurs sont recrutés avec des exigences de plus en plus basses. Au cours de la session extraordinaire de 2014 du concours de professeurs des écoles, la barre d’admissibilité était descendue jusqu’à 4/20 à Créteil, 5/20 à Paris et 4,5/20 à Versailles. Dans le secondaire, nous sommes passés de plus de 8000 candidats au Capes en 1997 à moins de 3000 après 2010, et la part des enseignants contractuels a fortement augmenté. De nombreux postes demeurent non pourvus, notamment en maths, en lettres classiques et en allemand.
À ces problèmes de recrutement qui doivent beaucoup à la dévalorisation salariale et symbolique de la fonction de professeur s’ajoutent les défauts structurels de notre système de formation. Celle-ci souffre tout d’abord d’un manque flagrant de pluridisciplinarité. On estime aujourd’hui que près de 70 % d’entre eux obtiennent des licences en sciences de l’éducation, discipline fort orientée idéologiquement. Beaucoup ont des lacunes en français et très peu suivent un cursus scientifique, ce qui n’est sans doute pas sans rapport avec le déclin de la culture scientifique dans notre société. Plus généralement, on ne s’autorise pas à appréhender le primaire dans sa spécificité par rapport au secondaire. Un professeur des écoles enseigne jusqu’à huit disciplines, là où un professeur du secondaire ne donne cours que dans une ou deux matières. Tous suivent pourtant les mêmes licences monodisciplinaires.
Seuls 55 % des enseignants déclarent en outre avoir été formés pendant leur période de formation initiale à la gestion de classe et du comportement des élèves, ce qui est inquiétant dans la mesure où les professeurs débutants sont souvent affectés dans des établissements plus défavorisés, inégalitaires et multiculturels. Trop de professeurs français s’estiment en outre insuffisamment soutenus en début de carrière.
Dans de nombreux pays de l’OCDE, les enseignants font du co-enseignement avec des collègues plus expérimentés pour faciliter leur entrée dans la profession et reçoivent une rémunération supplémentaire ou une réduction de leur volume de cours, ce dont nous pourrions peut-être nous inspirer. Autorisons-nous également une réflexion sur les mesures mises en place en Corée, au Canada et au Japon pour attirer les enseignants de qualité dans les établissements en grande difficulté : avancées de carrière, primes substantielles, classes à effectifs réduits, etc.
Comme l’explique Éric Charbonnier dans notre publication, l’absence de pratiques coopératives constitue une autre faiblesse de notre système pédagogique, à rebours de ce qui se fait dans les autres pays de l’OCDE. L’augmentation des synergies et des échanges entre collègues aideraient nos professeurs à se sentir moins livrés à eux-mêmes. D’autres leviers existent enfin pour redresser notre système de formation, à l’image par exemple du développement de la formation professionnelle afin de faciliter les évolutions de carrière de ceux qui en ressentent le besoin.
Une proposition évoquée durant le colloque consisterait à confier la formation des maîtres, actuellement effectuée par l’Université, à l’Éducation Nationale. Quelle est la logique derrière cette idée ?
Auparavant réservée aux Écoles normales, la formation des maîtres a été confiée à l’université en 1990, année de création des IUFM. Depuis, l’insatisfaction des acteurs de terrain n’a cessé de se faire entendre, les résultats des élèves français se sont effondrés et le métier de professeur a perdu en attractivité.
Les IUFM n’existent plus aujourd’hui. Ils ont été remplacés en 2013 par les Éspé et en 2019, par les Inspé, mais le problème de fond demeure. Il tient à la prégnance de l’idée selon laquelle les connaissances et compétences du professeur compteraient moins que la pédagogie envisagée de manière purement théorique. Selon cette approche, c’est l’élève qui est au centre de l’école et non pas les savoirs. Ceux-ci ne sont d’ailleurs plus transmis de manière verticale mais «co-construits», selon la formule consacrée. Le triomphe implacable des sciences de l’éducation évoqué ci-dessus rend compte de cette lame de fond idéologique. À cet écueil s’ajoute l’erreur de la mastérisation, à l’origine d’un curieux paradoxe : l’abaissement du niveau de formation des professeurs s’accompagne d’une élévation de leur niveau d’études. Un rapport de la Cour des comptes de 2012 soulignait pourtant l’impréparation de la réforme de 2010 (obligation d’être titulaire d’un M2 pour passer le concours de professeur des écoles) et la dégradation de la formation professionnelle que celle-ci portait en germe.
Lucide sur ce constat d’échec, le gouvernement tente actuellement de réformer la formation initiale, comme l’a expliqué le recteur de Paris Christophe Kerrero dans notre colloque : contrats d’alternance dans les classes, développement dans vingt académies d’un parcours préparatoire au professorat des écoles où la formation se fait en alternance entre l’université et le lycée, etc. Le développement de ces parcours préparatoires n’est néanmoins pas chose facile. Du fait de l’autonomie des universités, on ne peut pas obliger celles-ci à créer des licences pluridisciplinaires qui iraient pourtant dans le sens de l’intérêt général. Si les résultats attendus ne sont pas obtenus, on pourrait donc envisager à terme de rattacher la formation des professeurs à l’Éducation nationale elle-même. L’apprentissage y serait plus pluridisciplinaire, avec idéalement un volet recherche. Surtout, il se ferait véritablement au plus près des savoirs fondamentaux et de la pratique. Des écoles du professorat des écoles seraient donc créées. Celles-ci pourraient, en lien avec les universités, délivrer des équivalents de masters ou bien des diplômes d’écoles tout en préparant les futurs maîtres au concours.
Une telle réforme serait évidemment révolutionnaire et devrait faire face à de nombreuses résistances, qu’elles soient universitaires, syndicales, administratives ou encore politiques. Gardons cependant à l’esprit que la construction des Écoles Normales a demandé beaucoup d’énergie. Nous faisons face à un défi de même importance aujourd’hui. La qualité de notre école conditionne le développement intellectuel, économique et social de notre nation. Le déclin actuel, fruit de décennies de lâchetés et d’abandons, ne saurait être enrayé sans une réponse à la mesure de la situation.
Dans un autre colloque de janvier 2021, vos intervenants déploraient le manque de culture politique des professeurs sur la question de la laïcité. Est-ce aussi un angle d’amélioration dans la formation des enseignants ?
Cette question concerne moins les professeurs des écoles que ceux du secondaire. À l’occasion du colloque « Enseigner la République » auquel vous faites référence, Iannis Rodder rappelait que 27 % des enseignants s’autocensurent dès qu’il est question de religion à l’école. La religiosité pénètre toujours plus dans la vie quotidienne et les pratiques des élèves, laissant les professeurs désarmés face aux manifestations de séparatisme qui ne cessent de se multiplier. Bien souvent, ceux-ci ne se sentent pas assez soutenus en interne par les corps de direction et estiment, lorsqu’ils rapportent les problèmes, que la réponse est trop complaisante.
Ce paradigme du « pas de vague » n’est plus tenable. Sur la laïcité, le désarmement intellectuel des fonctionnaires de l’Éducation national est frappant. Les professeurs n’ont aujourd’hui plus de culture commune républicaine pour les épauler et s’estiment insuffisamment formés face aux tensions, revendications victimaires et comportements violents qui s’expriment. Les témoignages recueillis après l’hommage à Samuel Paty rendent compte de ces difficultés. Le dispositif destiné à mieux former les professeurs à la laïcité courageusement mis en place par Jean-Michel Blanquer, suivant les préconisations de Jean-Pierre Obin, va dans le bon sens mais il est trop tôt pour apprécier ses effets.
La formation des professeurs à la laïcité ne saurait être suffisante sans réflexion sur la manière dont celle-ci doit être enseignée aux élèves. Trop souvent, ces enjeux sont abordés par le biais d’un catéchisme moralisateur à l’occasion de cours d’éducation morale et civique dont les finalités ont été dévoyées depuis leur instauration par Jean-Pierre Chevènement en 1985. La laïcité souffre par ailleurs d’être réduite à une vision anglo-saxonne très peu républicaine insistant uniquement sur la liberté de conscience et la coexistence pacifique des religions et des sensibilités de chacun. On ne peut pas se contenter de parler des valeurs républicaines de manière abstraite aux élèves sans montrer en quoi celles-ci sont le produit d’une histoire spécifique et dynamique, de principes philosophiques nourris par des textes fondateurs ancrés dans notre imaginaire.
Comme le rappelle Natacha Polony, la République, pour être enseignée, a besoin de Rabelais, de Voltaire, de Rousseau et d’Hugo. Alors que l’émotion face au beau paraît étrangère aux préoccupations scolaires de notre temps et que les obscurantismes font leur retour de toute part, l’actualité du combat pour les humanités est évidente. Plus que jamais, notre héritage de nation littéraire nous oblige.