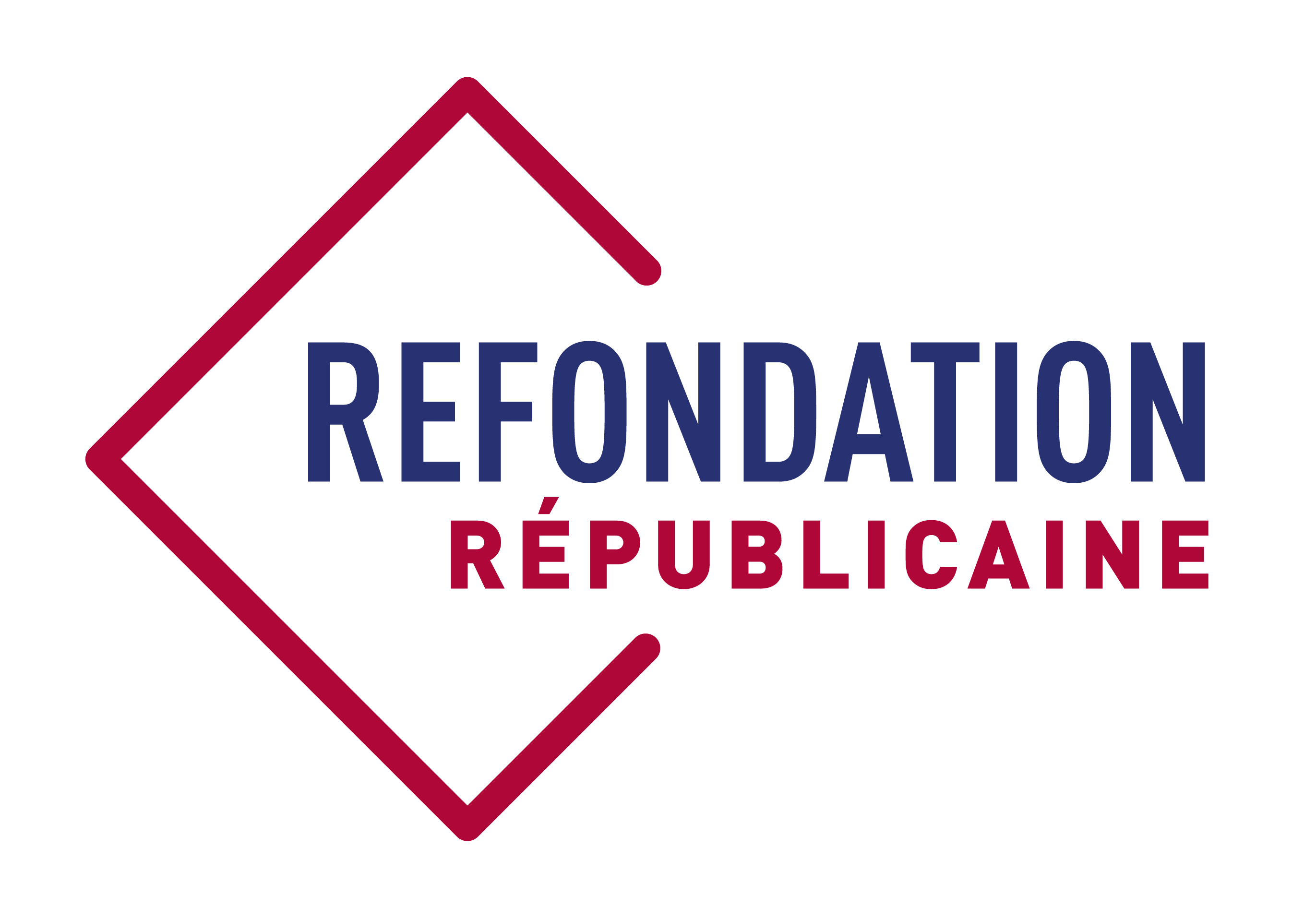Jean-Pierre Chevènement était l’invité de Thomas Legrand sur France Inter pour l’émission « En quête de politique », samedi 18 février 2023.
Verbatim
Thomas Legrand : En quête de politique, chaque semaine nous explorons une idée, une tendance, un mouvement politique, son histoire et son actualité, son poids dans nos débats. Cette semaine nous allons nous intéresser à un « -isme », une idée un peu particulière parce que le nom est composé de celui de son auteur, de l’homme qui l’a faite vivre depuis la fin des années 1960. Le débat politique voit s’affronter des idées désignées par le suffixe -isme, quelques-unes de ces idées sont plus conjoncturelles liées à une époque, à une personnalité. On avait hésité à appeler cette émission « rendez-vous avec -isme ». Il faut faire attention au fait que tous les « -ismes », avec un nom devant, ne sont pas des idées : le gaullisme, le mendésisme, le rocardisme correspondent bien quant à eux à des destins qui contiennent un corpus idéologique, prônent des solutions cohérentes, se situent dans une lignée historique ou à la croisée de plusieurs d’entre-elles. Le mitterrandisme, le chiraquisme, même s’ils ne sont pas idéologiquement neutres, sont des termes qui désignent plutôt une façon de faire de la politique, une façon de conquérir ou de conserver le pouvoir. Le « -isme » qui nous occupe aujourd’hui, le chevènementisme, s’inscrit définitivement dans la première catégorie, celle des idées. C’est une orientation politique. Aujourd’hui nous en parlons avec son créateur : Jean-Pierre Chevènement.
Beaucoup d’acteurs de la vie politique actuelle disent être passés par cette école de pensée, Emmanuel Macron lui-même se réclame de certains aspects du chevènementisme, tendance socialiste qu’il a même fréquentée pendant sa jeunesse. Aujourd’hui le chevènementisme évoque un républicanisme exigeant et une forme de souverainisme transpartisan. Au début, le chevènementisme était un courant du Parti socialiste, son aile gauche, animé par un homme d’État, un intellectuel qui transige peu avec ses principes. Nous verrons dans la seconde partie de l’émission avec le politologue Patrick Weil, qui fut chevènementiste dans les années 1970-1980, que si Jean-Pierre Chevènement ne transige pas avec ses principes, ses principes au fil du temps changent de nature. L’idée d’un interventionnisme socialiste se dissout dans la mondialisation libérale et le chevènementisme trouve refuge dans une sorte de républicanisme souverainiste. La cohérence de ce mouvement se trouve sans doute dans l’idée de trouver les moyens de garder vivace la souveraineté populaire. Le chevènementisme et ses évolutions, perçues ou non par son auteur, disent beaucoup de l’évolution de la France, de sa démocratie, de son identité politique républicaine tourmentée, de la fin des trente glorieuses à nos jours.
Le chevènementisme puise dans l’histoire révolutionnaire, c’est un descendant des Jacobins et pourtant il fut aussi auto-gestionnaire, un compagnonnage bousculé entre république et socialisme puis une sorte de patriotisme éclairé. Aujourd’hui les grognards du CERES (centre d’études, de recherches et d’éducation socialiste), qui va intégrer le Parti socialiste à sa création en 1971, Alain Gomez, Didier Motchane, Pierre Guidoni, Georges Sarre sont maintenant tous morts. Si Jean-Pierre Chevènement dit ne pas aimer le terme « chevènementisme », le plus simple reste de lui demander de le définir.
Entretien
- Thomas Legrand : « En quête de politique » explore les grands courants politiques. Aujourd’hui nous venons vous voir parce que nous aimerions traiter du chevènementisme. Si vous n’acceptez pas ce terme, vous connaissez peut-être la phrase d’Engels : « La preuve du pudding, c’est qu’on en mange. » La preuve du chevènementisme, c’est que certains s’en réclament. Qu’est-ce que c’est selon vous ?
Jean-Pierre Chevènement : J’accepte ce terme mais je préfère les gens qui se réclament des idées à ceux qui se réclament des personnes. Même si ceux qui m’ont suivi l’ont fait parce qu’ils se reconnaissaient dans certaines idées, beaucoup plus que par dévotion à ma personne. Je suis sociologiquement et idéologiquement républicain. Par conséquent, je préfère les gens qui se définissent à travers des analyses, des grilles de lecture, une certaine conception du monde. Vous m’interrogez sur le courant qui s’est formé dans la première partie des années 1960. Je revenais d’Algérie avec certains de mes camarades. Nous étions d’une génération marquée par la guerre et le contexte des guerres coloniales, donc nous étions pour l’indépendance de l’Algérie, sans pour autant chercher à nous soustraire à nos obligations militaires. C’est au retour de la guerre d’Algérie que nous avons fait le choix de créer au sein du Parti socialiste, qui à l’époque était la SFIO, une mouvance qui avait pour but de structurer une pensée axée sur l’union de la gauche.
Pour bien comprendre ce que vous appelez le chevènementisme, il faut se reporter au début des années 1960. Khrouchtchev, dans son fameux rapport, critique le stalinisme et ouvre la voie à une négociation possible et à des échanges avec le courant socialiste. Notre idée, était d’adhérer au Parti socialiste pour en infléchir le court, pour faire en sorte que l’union de la gauche, réalisée entre communistes et socialistes, laisse place à l’émergence d’une énergie politique capable de faire bouger les lignes en France. Nous n’étions pas anti-gaullistes. Nous étions très marqués par la critique de la IVe République, cette espèce de parlementarisme bâtard qui avait conduit à un régime d’impuissance. Nous étions, au fond, assez favorables aux institutions données à la France par le général de Gaulle.
- Thomas Legrand : Pouviez-vous vous définir à l’époque comme gaullistes de gauche ?
Jean-Pierre Chevènement : Nous aurions pu, mais nous avons préféré prendre appui sur le Parti socialiste pour donner à la Ve République une base de gauche et non pas pour influencer le général De Gaulle que nous ne connaissions pas, pour l’amener sur des positions de gauche. Puis ça n’était pas possible à mesure que notre idée était de nous allier au parti communiste. Nous pouvions adhérer aux idées du général De Gaulle en matière de politique étrangère et de défense néanmoins. Nous avons pu rallier le Parti socialiste à la doctrine de la dissuasion nucléaire. Sur le plan des institutions, nous pouvions voir, dans celles données par le général de Gaulle à la France, une occasion d’établir un rapport de force avec le Parti communiste, ce qui n’allait pas de soi en 1964 parce qu’à cette époque le Parti socialiste était très faible.
- Thomas Legrand : Vous étiez marxiste critique ou déjà républicain affirmé ?
Jean-Pierre Chevènement : Nous étions d’abord des républicains et si on nous interrogeait sur le marxisme nous ne récusions pas une certaine lecture qui relevait plutôt de la philosophie de l’histoire et non pas du matérialisme historique, l’idée que nous pouvions comprendre beaucoup de choses à travers l’analyse du rapport de classes, des rapports de production et, bien sûr, l’idée que l’idéologie dominante était l’idéologie de la classe dominante. Les écrits politiques de Marx nous intéressaient mais je ne me définissais pas comme marxiste. Nous n’étions pas communistes, c’est sûr, nous étions plutôt ce qu’on appelait à l’époque des menchevik, à l’époque de la révolution russe, par rapport aux bolchéviques. Nous croyions à l’analyse traditionnelle des socialistes : « Modifions le rapport de production et aidons la société à se développer afin de faire naître une classe ouvrière qui prendra peu à peu en main les instruments de commande. » C’était le discours républicain.
Extrait d’archive, Jean-Pierre Chevènement en 1972 : L’autogestion à proprement dite vient après, dans le cadre d’une économie déjà socialiste, ou au moins dans le secteur public, pour donner aux travailleurs la maîtrise de leur outil de production. La différence avec la participation est fondamentale parce que celle-ci, telle qu’exposée par les gaullistes, se conçoit dans le cadre d’un régime capitaliste et transforme l’ouvrier en petit capitaliste. Le but du socialisme n’est pas de faire des petits capitalistes mais de faire une société libérée.
Reprise de l’entretien
- Thomas Legrand : Cette archive est intéressante, vous avez entendu Jean-Pierre Chevènement parler de la participation et du gaullisme. Il est bien plus critique du général que ce que son souvenir exprime aujourd’hui.
Jean-Pierre Chevènement : Je pense que la genèse est importante parce qu’on ne peut pas comprendre la suite si on ne comprend pas la naissance du CERES dans les années 1960, dès la fin de 1965, le début de 1966 plus précisément, et notre rencontre avec François Mitterrand. Nous ne le connaissions pas quand nous avons fondé le CERES.
- Thomas Legrand : Avant de parler de votre rencontre avec Mitterrand et de votre rôle au congrès d’Épinay en 1971 et lors de la création du Parti socialiste : le CERES apparaît, quand on le regarde avec presque soixante ans de distance, comme quelque chose qui pouvait être quelque peu anachronique à l’époque parce que vous étiez républicains, vous aviez cette texture marxiste, à un moment où une grande partie de la gauche française commençait, un peu avant 1968, à ne pas revendiquer la République et à ne plus se référer à la révolution Française. On se disait « gauche moderne ». On parlait presque déjà de « gauche américaine », juste après Kennedy. C’est vous qui aviez inventé ce terme.
Jean-Pierre Chevènement : Oui, comme un sobriquet tournant en dérision ces courants qui se fondaient sur ce qui se passait aux États-Unis. La gauche sociétale, soixante-huitarde, libérale et individualiste portait déjà en son sein les prémisses d’une certaine idéologie plus ou moins écologiste. Nous, nous étions dans la tradition de la gauche républicaine historique. Cette gauche-là a survécu et existe toujours à mes yeux. C’est toujours la bonne.
- Thomas Legrand : Comment se passe la rencontre entre François Mitterrand, ministre plusieurs fois pendant la IVe République, un socialiste nouveau, qui n’a pas envie, à priori, de s’allier avec le Parti communiste, et vous ? Quelles sont vos discussions politiques et stratégiques au départ ?
Jean-Pierre Chevènement : S’il n’en a pas envie, il a compris que, s’il voulait revenir au pouvoir, il devrait s’allier au parti communiste. Je me souviens d’une histoire en particulier. En 1960, François Mitterrand, entraîne un jeune sous-préfet qui deviendra ensuite préfet de Bourgogne, M. Pinel, après une balade au bord de Loire, il revient et lui dit : « J’ai compris une chose. Alain Peyrefitte a raison quand il dit qu’ils sont (la droite) au pouvoir pour trente ans, sauf si on s’allie au Parti communiste. » À l’époque, et même dix ans après, le Parti communiste est encore puissant, et François Mitterrand a vu l’opportunité d’un rapprochement avec ce parti. Il n’en mesurait néanmoins pas toute la profondeur historique mais c’est à partir de 1965 que nos rapports s’établissent. François Mitterrand cherche des gens qui puissent faire des interviews, des textes, à sa place et nous nous offrons, nous sommes quelques-uns, pas très nombreux, à lui servir de porte-plume.
- Thomas Legrand : En 1964 François Mitterrand écrit Le coup d’État permanent, dénonçant la dérive personnaliste de la Ve République et le général de Gaulle. Vous, au CERES, vous êtes déjà pour la Ve République. Comment est-ce que vous réglez cette question à la fin des années 1960 ? Est-ce que vous avez une discussion sur les institutions ?
Jean-Pierre Chevènement : Non, car nous pensons que François Mitterrand utilisera les institutions et qu’il ne les mettra pas en danger même s’il les avait critiquées. C’était un morceau de bravoure dont il était très fier. Il disait que c’était son meilleur livre, mais nous ne l’avions pas vraiment lu et faisions confiance à la logique de la situation.
- Thomas Legrand : En intégrant le Parti socialiste et en apportant votre pierre à celui-ci, vous avez installé François Mitterrand et la stratégie de l’union de la gauche.
Jean-Pierre Chevènement : C’était la condition. Nous n’aurions pas soutenu François Mitterrand s’il n’avait pas embrassé la stratégie de l’union de la gauche du programme commun. Rappelez-vous du célèbre discours à la fin du congrès d’Épinay où il dit qu’il n’y aura pas accession de la gauche au pouvoir s’il n’y a pas d’union sur la base d’un programme socialiste dont la charge serait confiée à Jean-Pierre Chevènement. Je serai l’un des négociateurs du programme commun et après que les communistes auront rompu avec la stratégie du programme commun, François Mitterrand fera à nouveau appel à moi pour élaborer le programme socialiste pour les années 1980.
- Thomas Legrand : François Mitterrand a alors une phrase célèbre : « Quiconque ne veut pas la rupture avec le capitalisme ne peut pas être au Parti socialiste. » Est-ce que cette phrase est de vous ?
Jean-Pierre Chevènement : Non, c’est une trouvaille oratoire. Il faut faire confiance à François Mitterrand et à ses trouvailles oratoires. Le programme en commun était précis, c’était un vade-mecum pour la gauche au pouvoir.
- Thomas Legrand : C’était un vade-mecum pour accéder au pouvoir ou pour gouverner ?
Jean-Pierre Chevènement : C’est toute l’ambiguïté de notre alliance. Dans notre esprit, c’était un vade-mecum pour gouverner et la base même du programme du Parti socialiste était une politique industrielle avec des feuilles de route données à des grands groupes précédemment nationalisés pour moderniser la France, la rendre plus compétitive et la projeter à l’échelle mondiale. C’est un programme qui devait beaucoup à une certaine inspiration gaulliste et c’est avec cela que la gauche au pouvoir a rompu. Le canal de cette rupture, ce qui n’est jamais dit, c’est la présidence de la Commission européenne confiée à Jacques Delors à l’instigation d’Helmut Kohl et l’élaboration du marché unique : un espace délivré de toutes règles en matière de circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes.
- Thomas Legrand : À partir du moment où il y a ces règles, cette politique de planification et d’industrialisation volontariste que vous aviez élaborée, s’effondre ?
Jean-Pierre Chevènement : C’est la raison pour laquelle je quitte le gouvernement. Tout cela se comprend, et une fois qu’on a compris, on comprend également pourquoi le CERES se refonde et choisit le sursaut républicain, la refondation républicaine. C’est ce que nous faisons à l’Éducation nationale et au ministère de l’Intérieur. C’est un autre discours que nous substituons au discours initial.
- Thomas Legrand : Vous commencez par exercer dans un ministère économique, à l’industrie, et après vous avez des ministères régaliens. Le chevènementisme, change un peu à ce moment-là. Vous passez de l’économie au régalien, du marxisme républicain au républicanisme et à la laïcité. On a l’impression que vous êtes moins à gauche, ou du moins qu’elle a moins d’importance à ce moment-là. La république et la gauche vont main dans la main selon les mots de Jaurès sans doute, mais n’y a-t-il pas une évolution ?
Jean-Pierre Chevènement : Il n’y a pas d’évolution pour ce que nous pensons au fond de nous-mêmes mais la gauche a évolué en rompant avec ce qui était le pacte fondateur, cette volonté de changer la société française à partir de ses propres fondamentaux. On peut dire que le CERES se maintient sur une ligne républicaine et on ne peut pas parler du chevènementisme, comme vous dites aujourd’hui, sans se référer à un certain sens de l’État. C’est ce sens de l’État qui va marquer mon passage dans certains ministères : notre devise est alors « ni périr, ni trahir » et nous y sommes restés fidèles. Nous avons naturellement choisi d’accéder aux mêmes buts par une autre face qui était le remodelage des institutions, des références à la République et à la citoyenneté, et la redéfinition de notre politique industrielle.
Extrait d’archive, Jean-Pierre Chevènement, avant l’élection présidentielle de 2002 : Il y a deux candidats non-candidats, Jacques Chirac et Lionel Jospin qui bloquent le débat et utilisent leur position institutionnelle pour faire une campagne qui ne dit pas son nom. J’ai fait des propositions et réuni des gens très divers parce qu’ils ont en commun une exigence républicaine, un patriotisme, un amour de la France qui fait qu’ils voient bien qu’avec les deux candidats du système, il n’y a pas pour la France d’avenir clair et lisible. Nous avons en commun de croire en des valeurs républicaines d’égalité, de laïcité, de citoyenneté, à l’égalité de droit et de devoirs et nous les croyons menacées. C’est ce qui nous réunit.
Je dis qu’au-delà de la droite et de la gauche, il y a la République qui est une exigence. Eux se disent républicains mais ils ne pratiquent pas. Ils ne sont républicains que le 14 juillet comme certains fidèles ne vont à la messe qu’à Pâques ou à la messe de minuit. Je crois qu’il y a une exigence républicaine qui se manifeste par exemple à travers la mise en œuvre d’une politique cohérente de sécurité qui fait défaut, à travers des missions clairement définies à l’école, à travers une politique européenne qui ne nous prive pas de l’exercice de nos droits démocratiques. Tout cela a été laissé en quenouille. À chaque fois que j’ai travaillé au sein d’un gouvernement je l’ai fait au service de l’intérêt public, et me suis séparé des gouvernements auxquels je participais quand ils tournaient le dos sur certains principes, comme en Corse où on a aboli la loi égale pour tous.
Reprise de l’entretien
- Thomas Legrand : Plus tard, le chevènementisme, qui était une stratégie d’union de la gauche, devient synonyme de dépassement gauche-droite avec un moment où vous essayez de mettre dans un même mouvement quelqu’un comme Nicolas Dupont-Aignan et des gens de gauche.
Jean-Pierre Chevènement : Notre interlocuteur était plutôt Philippe Séguin, Dupont-Aignan n’existait pas encore politiquement. Nous ne tournions pas vraiment le dos à la gauche, c’est elle qui tournait le dos à ses fondamentaux et qui nous obligeait à trouver un autre chemin. Nous cherchions donc un dépassement et, pour trouver une majorité, nous tendions la main à ceux qui, comme Philippe Séguin, représentaient une orientation pouvant rejoindre la nôtre. Je n’offense pas la vérité en disant qu’il y avait plus d’une convergence entre ce que représentait le CERES, la gauche socialiste et Philippe Séguin.
- Thomas Legrand : François Mitterrand a alors une phrase célèbre : On a quand même réussi, pendant cet entretien, à cerner un cadre idéologique, un chemin. Est-ce que vous diriez donc qu’il n’est pas idiot de parler de chevènementisme ?
Jean-Pierre Chevènement : Si on comprend le cheminement, mais ce cheminement est-il compris ? Par certains, par fragments, il l’est. Dans son entièreté, ce n’est pas évident. Pourtant, il a sa logique et la logique républicaine est quelque chose qui tient la route aujourd’hui et permet de répondre à beaucoup de questions, dans le domaine de l’école et sa réorientation à partir des valeurs de la transmission. Sur le problème de l’intégration des jeunes nés de l’immigration. Je pense qu’on peut dérouler toutes les conséquences pratiques d’une idéologie qui correspond à une situation donnée de la société française, une certaine archipellisation, une certaine dissociation, un certain désordre. En face nous défendons quelque chose de sérieux, solide, de républicain.
Entretien sur le chevènementisme avec Patrick Weil
Patrick Weil : J’étais le responsable des jeunes du CERES. J’ai été le plus jeune élu au comité directeur du Parti socialiste, pendant la campagne de Mitterrand en 1981 et j’ai même fait la campagne de Mitterrand en 1974. J’avais dix-sept ans à l’époque. Le CERES, c’était l’adhésion à la gauche du Parti socialiste, avec la volonté de faire revenir la gauche au pouvoir mais un pouvoir qui transforme. Quand j’ai adhéré au Parti socialiste en 1972, j’étais lycéen, c’était un peu ringard. J’étais dans un lycée bourgeois du 16e arrondissement avec une section communiste de cinquante personnes (il y en avait cent à la ligue révolutionnaire) et j’étais le seul socialiste.
- Thomas Legrand : Le CERES en 1971, avant votre arrivée, quand le Parti socialiste est créé au congrès d’Épinay, c’est la tendance qui convint François Mitterrand qu’il faut, pour conquérir le pouvoir, que la gauche communiste et la gauche socialiste s’allient.
Patrick Weil : Pour l’union de la gauche, pour une transformation profonde de la société capitaliste, pour l’instauration de l’autogestion, pour une transformation de la société et de l’État. Je suis devenu marxiste. Le CERES, par lequel, beaucoup de responsables, d’intellectuels, de hauts fonctionnaires sont passés, a donné au Parti socialiste, entre Épinay et l’arrivée de la gauche au pouvoir, sa structuration intellectuelle. Je n’étais pas soixante-huitard. Le CERES cherche à cristalliser les mouvements des idées portées par mai 1968, avec une gauche plus classique. Les fondateurs du CERES faisait partie de la SFIO avant 1968, marqués par l’Algérie. C’était une sorte de pari absolument incroyable : unir à la fois les forces qui n’étaient pas communistes et faire l’alliance avec ceux-ci pour faire triompher les forces de gauche rassemblées.
- Thomas Legrand : Si on fait le panorama de la gauche de l’époque, il y a les communistes qui sont plus puissants que les socialistes. Ces derniers sont assez divers. Il y a les soixante-huitards qui se répartissent dans des groupes d’extrême-gauche, ou au PSU (Parti socialiste unifié). Il y a le CERES. Tout cela est très disparate.
Patrick Weil : Dans la particularité du CERES il n’y a pas l’anti-étatisme qu’il y avait dans certains courants soixante-huitards. Il y a déjà l’attachement à l’État républicain. […] On ne disait pas républicain à l’époque. On avait un attachement à la République et à l’État sans en parler tous les jours comme aujourd’hui. […] Le CERES se référait à l’autogestion avec un parfum révolutionnaire. Ma génération l’a vécu. On pouvait être révolutionnaire et s’inscrire dans la République. Le CERES se plaçait à un lieu de cristallisation de l’ensemble des forces mais c’était d’abord une force de transformation de la gauche réformiste. Quand on regarde aujourd’hui le Parti socialiste, et la gauche dans son ensemble, on voit l’incroyable travail intellectuel fourni. C’était la colonne vertébrale et intellectuelle du Parti socialiste. Le fait est, qu’à des moments décisifs de la conquête du pouvoir par Mitterrand, le CERES s’est trouvé indispensable. Didier Motchane, Pierre Guidoni, Georges Sarre et Jean-Pierre Chevènement savaient influencer la ligne. Lorsque Mitterrand a affronté Mauroy et Rocard, c’est le CERES qui a permis de gagner le congrès de Metz de 1979.
Il y avait un slogan après le coup d’État qui a fait tomber Salvador Allende en 1973, c’était : « ni périr, ni trahir ». La trahison était quelque chose de très important parce que la dernière fois que la gauche était arrivée au pouvoir en 1956, les gens avaient pensé voter Mendès France et ils avaient eu Guy Mollet qui avait renforcé le contingent en Algérie. Il y avait une grande partie de la génération antérieure à la nôtre qui ne croyaient plus en la gauche du fait de ce traumatisme politique qui a mis la gauche à l’écart du pouvoir pendant vingt-cinq ans. Ne pas trahir, c’était rester fidèle aux engagements pris. Quand on voit Mitterrand, après 1981, il a fait ses 110 propositions et il y avait l’idée qu’on se tiendrait au programme qu’on annonçait, mais qu’il ne fallait pas être renversé par un coup d’État.
- Thomas Legrand : On était dans l’idée post-Allende que la gauche soit se délite au pouvoir ou est renversée.
Patrick Weil : Quand on voit le programme appliqué en 1981, c’était un programme très radical. La nationalisation des grandes banques, des grandes entreprises, ça a été appliqué. C’était quelque chose de massif. Quand on regarde le programme de la gauche aujourd’hui, ça va beaucoup moins loin que le programme de 1981 qui a été mis en œuvre.
- Thomas Legrand : Pourtant la devise de Jean-Pierre Chevènement et du CERES n’a pas été tenue.
Patrick Weil : Pas dans les deux premières années. J’étais chef de cabinet d’un ministre de l’immigration. On a fait la plus grande régularisation de l’histoire de la République avec de nombreuses nationalisations : le programme a été appliqué. Il y a des choix qui ont été faits en 1983, puis le retour de la droite au pouvoir, mais Mitterrand tenait bien à dire qu’il n’avait pas changé et qu’il avait appliqué son programme. C’était fondamental de construire un programme de transformation radicale qui n’entraînait pas pour autant l’effondrement.
- Thomas Legrand : Dans le CERES des années 1970, est-ce qu’un jeune de votre âge, après mai 1968, qui rejoint des intellectuels républicains qui étaient peut-être un peu gaullistes de gauche (c’est du moins la définition qu’en fait Jean-Pierre Chevènement), y trouvait une réalité ? Est-ce que c’est une réécriture ?
Patrick Weil : Le sujet était l’union de la gauche avec les communistes. L’idée était de faire un programme commun de propositions et de ne pas s’enfermer dans un débat idéologique qui n’aurait mené nul part. Les institutions de la Ve République n’étaient pas le sujet.
- Thomas Legrand : Le mot « chevènementisme » a changé de définition, parce que s’il est né comme la gauche du Parti socialiste, on a l’impression qu’au fil des différentes démissions de Jean-Pierre Chevènement, il a quitté les rives du débat économique pour aller vers le régalien et la République. Le mot chevènementisme a changé d’acception.
Patrick Weil : Le mot, au contraire, devient. Il existe à ce moment-là. La rupture de 1983, pour les gens du CERES, c’est une rupture avec le socialisme : Mitterrand rompt avec le socialisme. Chevènement quitte le gouvernement mais y revient en 1984 alors que la logique économique choisit en 1983, contre laquelle il s’était élevé, était toujours à l’œuvre.
- Thomas Legrand : Cela vous a étonné en 1984 ?
Patrick Weil : Il revient au gouvernement pour sortir le ministère de l’Éducation nationale de la crise alors que la réforme Savary mettait les Français dans la rue. Il revient en homme d’État et c’est là qu’on peut voir la naissance du chevènementisme.
- Thomas Legrand : Jean-Pierre Chevènement, c’est aussi l’homme qui démissionne, plusieurs fois.
Patrick Weil : Mais il revient au gouvernement, et il continue de servir l’État, même quand il n’est plus au gouvernement.
- Thomas Legrand : Plus tard, dans les années 1990, à partir de 1992, puis 2002 et 2005, le chevènementisme prend comme acception le souverainisme.
Patrick Weil : Je maintiens que c’est l’attachement à la République et à un État qui permet aux citoyens d’avoir prise sur leur destin.
Conclusion
Thomas Legrand : Pour compléter le tableau que Patrick Weil vient de nuancer et pour percer la nature de Jean-Pierre Chevènement, ce personnage qui avait de l’épaisseur culturelle, et bénéficiait de cette qualité indéfinissable mais rapidement décelable, il faut écouter le texte écrit et lu par lui-même en introduction d’un téléfilm dont il est le co-auteur, en 1977. Il s’agit de l’histoire de Louis Rossel qui est le seul officier supérieur de l’armée défaite de 1870 qui décide de rejoindre la Commune de Paris. Il refusait la capitulation et épousait les idées généreuses et utopistes des communards. Il était ministre de la Défense de la Commune mais s’est vite brouillé avec les autres chefs communards qui n’avaient pas réussi à discipliner cette armée rebelle et hirsute. Il fut condamné à mort et exécuté par les Versaillais, un mélange de patriotisme, d’utopie humaniste et d’amour de l’ordre. Jean-Pierre Chevènement présente ici l’homme qu’il admire et parle aussi de lui et de son idéal.
Jean-Pierre Chevènement dans le prologue du téléfilm de 1977, Rossel et la Commune de Paris : L’histoire de Louis Nathaniel Rossel est d’abord une belle histoire romantique et tragique à la fois. Comment un officier du second empire peut-il rejoindre les rangs de la Commune de Paris et en devenir le ministre de la Guerre ? Élève au Prytanée militaire de la Flèche puis jeune polytechnicien quelques années plus tard, il dissimule bien, sous un maintien de petit chose, un esprit rigoureux. « J’ai l’habitude, dit-il, de pousser les déductions jusqu’au bout. » Et en effet Rossel, ne vivra qu’un trait de feu parce que c’est un homme qui dit non : non à la capitulation de la France, non au suicide de la Commune. Il se brouille avec tous les camps mais Versailles, en le faisant fusiller, fera de sa vie un chef-d’œuvre. Sa mort nous interpelle encore aujourd’hui avec une force extraordinaire car Rossel pose les questions fondamentales et toujours actuelles : celles de l’honneur, de l’obéissance militaire, de la légitimité. Mais aussi celle, décisive pour tous ceux qui veulent changer la société, de la nécessité de l’ordre dans la Révolution. La discipline est-elle compatible avec la démocratie ? La mort de Rossel, enfin, c’est l’affirmation de la supériorité de la conscience face à tout pouvoir.
Source : En quête de politique – France Inter